[CINÉMA] Je suis toujours là, un drame des années de plomb brésiliennes

Nous sommes en 1971, à Rio de Janeiro, en pleine dictature militaire du président Emílio Garrastazu Médici. Rubens Paiva, député du parti travailliste brésilien dont le coup d’État du 31 mars 1964 a mis fin au mandat, vit confortablement avec sa famille en tant qu’ingénieur civil. Discret mais toujours politisé, Paiva apporte secrètement son soutien et son aide aux militants de gauche et aux socialistes révolutionnaires installés au Brésil comme à l’étranger. Son épouse, Eunice, et ses cinq enfants ignorent tout de ses activités parallèles. Ainsi, la famille baigne quotidiennement dans l’insouciance et la légèreté. Le foyer, véritable lieu de vie où les invités vont et viennent, jouent, chantent et débattent, a tout d’un havre de paix, préservé du tumulte politique extérieur. Un jour, pourtant, des hommes armés frappent à la porte et embarquent Rubens Paiva pour une simple « déposition ». Les heures passent, et le père de famille ne revient toujours pas. Eunice, à son tour, est emmenée avec l’une de ses filles et relâchée quelques jours après, sans la moindre explication. Durant trente ans, la famille Paiva n’aura de cesse de vouloir comprendre ce qui est arrivé à Rubens, dans la nuit du 21 au 22 janvier 1971…
Les années de plomb brésiliennes
Adapté de la biographie éponyme d'Eunice Paiva, écrite par son fils Marcelo, Ainda estou aqui (« Je suis toujours là », en version française) s’affiche comme le témoignage saisissant d’une époque révolue mais pas si lointaine. Réalisé par Walter Salles, qui a lui-même fréquenté la famille Paiva à l’époque des faits, le film rend hommage aux quatre cents morts ou disparus du régime militaire brésilien.
Pour mémoire, au début des années 1960, le pays fut secoué par de nombreux mouvements sociaux, au point d’inquiéter les milieux libéraux et l’armée qui craignaient, à terme, de voir le Brésil tomber aux mains des communistes. Avec l’aide de la CIA, via l’opération « Brother Sam », le maréchal Castelo Branco renversa, le 31 mars 1964, la Quatrième République et son président João Goulart, considéré comme trop faible face à la menace rouge, et instaura une dictature militaire qui dura jusqu’en 1985 avec l’élection de Tancredo Neves.
Dans le contexte de la guerre froide où les États-Unis se livraient à une guerre d’influence avec l’URSS, tous les coups étaient permis, y compris la déstabilisation de l’Amérique latine. De là la participation de la CIA à plusieurs coups d’État : en Argentine (1976), en Bolivie (1971), au Chili (1973), en Équateur (1961 et 1963), au Guatemala (1954) et, bien sûr, au Brésil (1964)… On pourrait, également, évoquer le soutien plus ou moins actif des États-Unis à l’opération Condor, au milieu des années 70, cette campagne d’assassinats d’opposants politiques (souvent marxistes) menée conjointement par le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.
À ce sujet — Cinéma / Spielberg et l’affaire des Pentagon Papers
Le choix de la mélancolie
On l’aura compris, Je suis toujours là, de Walter Salles, n’est ni un film politique ni un film-dossier, comme a pu l’être le récent Pentagon Papers, mais sa force n’est pas pour autant négligeable. Privilégiant les longs moments de bonheur de la famille Paiva, immortalisés par les couleurs chaudes de la pellicule Super 8 des films de vacances, et s’attardant aussi bien sur un premier acte d’exposition que sur les suites de la disparition du père, ce récit nostalgique et mélancolique joue à fond la carte de l’humanisation – ce à quoi, précisément, n’a pas eu droit la victime entre les mains de ses bourreaux…
Le cinéaste confie, pour l’occasion, à Fernanda Torres un rôle mémorable de mère courage qui n’a d’autre choix, pour continuer de s’occuper de ses enfants, que de garder la tête froide.
4 étoiles sur 5
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
Popular Posts
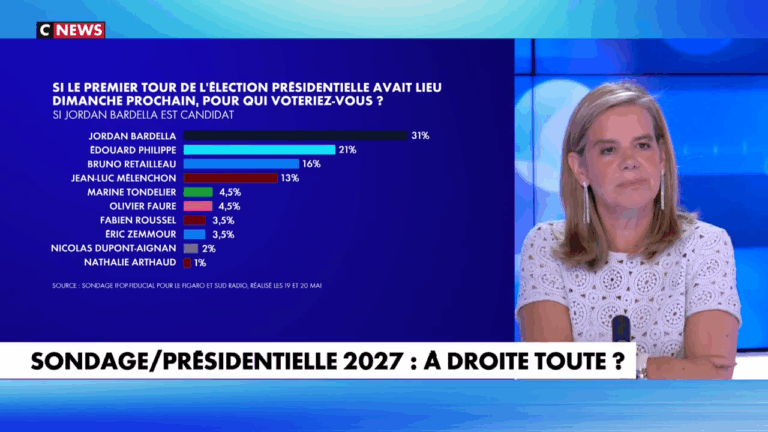










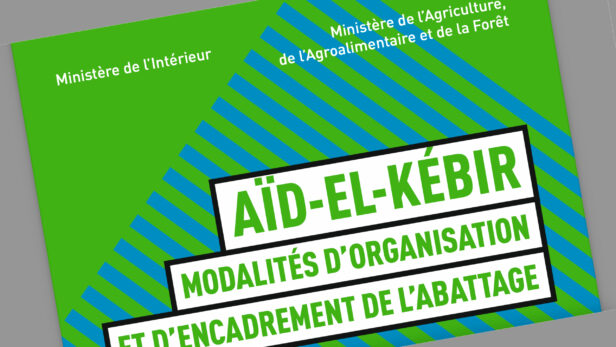

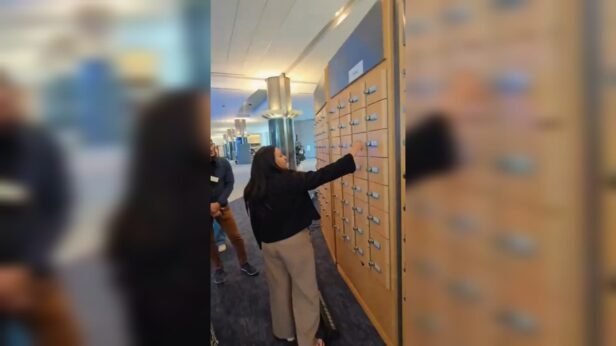






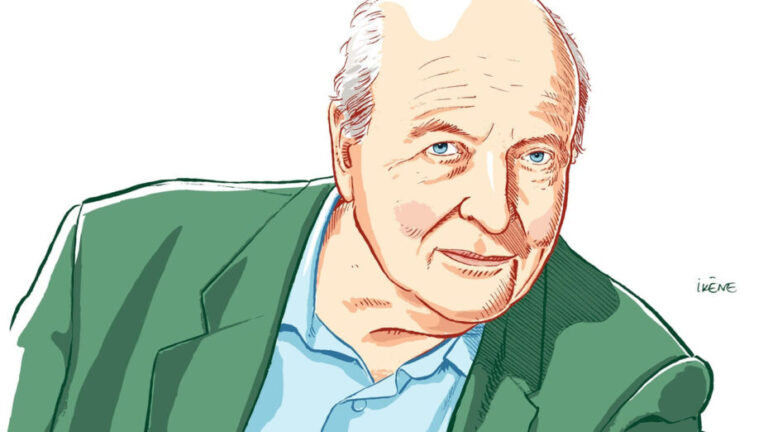


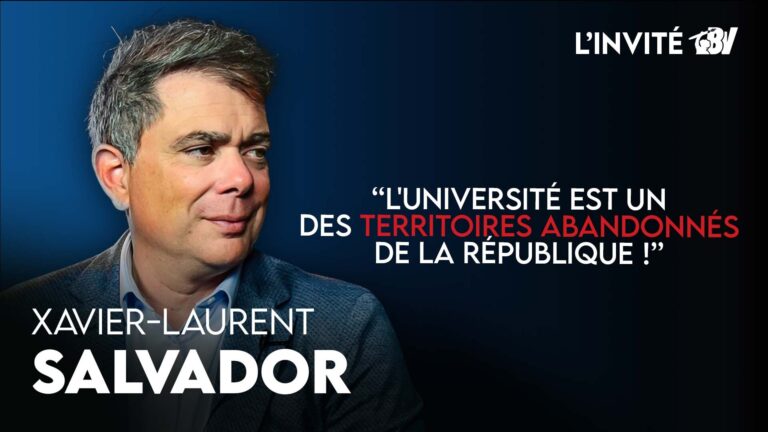

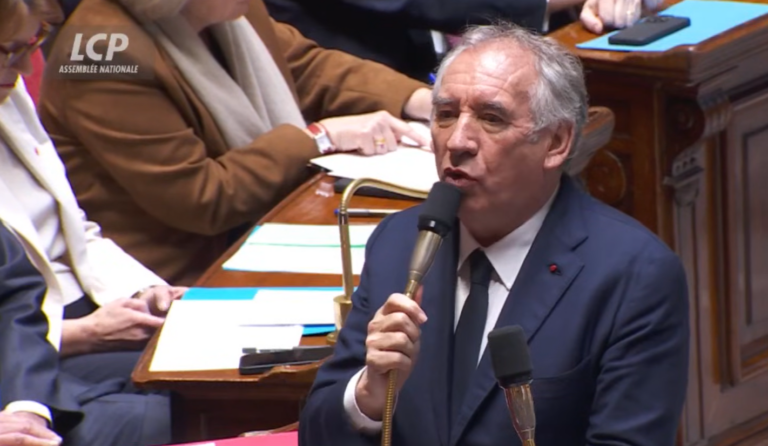






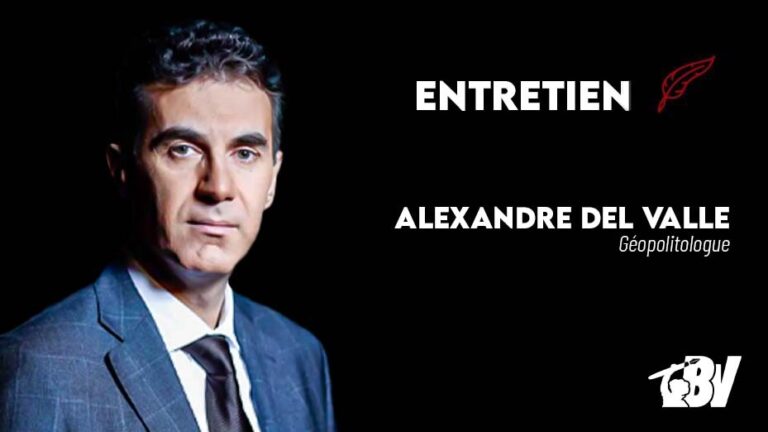


9 commentaires
Pas politique ce film? À lire le scénario on en douterait.
Excellent film sans pathos et sans message politique envahissant
Bien sûr il s’agit des exactions de la droite …mais c’est une histoire vraie ..Le film est bien fait ,bien joué et émouvant.
400 morts en 20 ans? Et on appelle cela une dictature?
Encore un film qui met en lumières les atrocités faites par un gouvernement de droite, jamais un seul sur les millions, les dizaines de million, les centaines de millions de victimes du communisme dans le monde. Simple constatation.
Oui d’accord
Ah mais il y a les bon morts et les mauvais tout comme les bon dictateurs et les mauvais c’est selon de quel côté on se place. Il se trouve des cultures pour qui la mort n’a pas la même signification, ainsi vas le monde.
Mon beau frère est toujours là : 94 ans, maigre et sec comme une tige, écrivain ex-doctorant totalement désargenté, mais bon pied bon oeil; à Biarritz: Torturé dans les geôles de la junte, considéré comme disparu durant deux ans ; Exfiltré de façon rocambolesque via l’Argentine puis la Belgique par l’Alliance française. Lui (grande famiille noble propriétaire d’haciendas depuis trois siècles) qui haissait, et les jésuites et les colonels, au soir de sa vie discute aimablement avec son colonel de bauf, rentre faire ses dévotions à l’église et se signe et décoiffe aux calvaires et statues mariales !
Je trouve minimisé le nombre de morts et disparus sous la dictature brésilienne: on serait plutôt proche du millier, soit au vu du nombre d’habitants, très loin des 3000 de Pinochet et des 15.000 de Videla en Argentine. Et pour le Chili, on peut difficilement parler de « participation » de la CIA, mais d’un soutien actif.
Je me permettrai de conseiller aux éventuels intéressés de regarder le film en VOST. Le portugais du Brésil, c’est du miel.